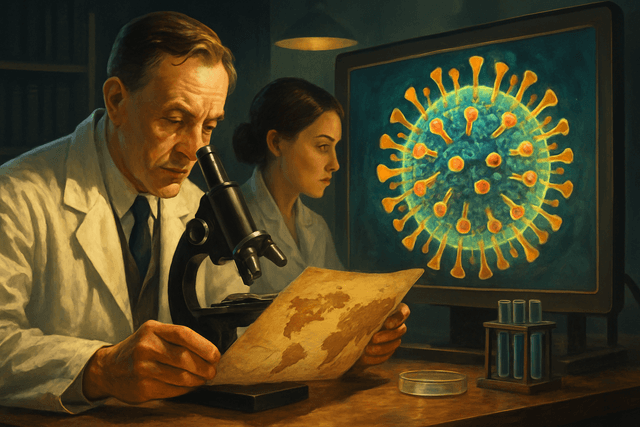Une équipe internationale de chercheurs dirigée par la paléogénéticienne, la professeure Verena Schünemann, a réalisé une avancée remarquable dans la compréhension de l’une des pandémies les plus meurtrières de l’histoire en reconstituant le premier génome suisse du virus de la grippe de 1918.
Les chercheurs ont utilisé un échantillon de virus vieux de plus de 100 ans, issu d’un spécimen fixé au formol de la collection médicale de l’Université de Zurich. L’échantillon provenait d’une patiente de 18 ans décédée lors de la première vague de la pandémie en juillet 1918 et ayant fait l’objet d’une autopsie.
« C’est la première fois que nous avons accès à un génome de la grippe de la pandémie de 1918-1920 en Suisse », explique la professeure Schünemann. « Cela ouvre de nouvelles perspectives sur la dynamique d’adaptation du virus en Europe au début de la pandémie. »
L’analyse génétique a révélé que la souche suisse possédait déjà trois adaptations clés à l’humain qui allaient persister dans la population virale jusqu’à la fin de la pandémie. Deux de ces mutations rendaient le virus plus résistant à un composant antiviral du système immunitaire humain — une barrière cruciale contre la transmission des virus grippaux d’origine aviaire des animaux vers l’humain.
Contrairement aux adénovirus, constitués d’un ADN stable, les virus de la grippe portent leur information génétique sous forme d’ARN, qui se dégrade beaucoup plus rapidement. « L’ARN ancien n’est préservé sur de longues périodes que dans des conditions très spécifiques. C’est pourquoi nous avons développé une nouvelle méthode pour améliorer notre capacité à récupérer des fragments d’ARN ancien à partir de tels spécimens », explique Christian Urban, premier auteur de l’étude.
Cette recherche pionnière démontre comment les outils avancés d’analyse génomique alimentés par l’IA révolutionnent notre compréhension des agents pathogènes historiques. En examinant les caractéristiques génétiques qui ont rendu le virus de 1918 si mortel, les scientifiques acquièrent des connaissances essentielles pour prévenir et répondre aux futures menaces pandémiques. La nouvelle méthode développée pourra désormais servir à reconstituer d’autres génomes de virus à ARN anciens, permettant aux chercheurs de vérifier l’authenticité des fragments d’ARN récupérés.
Les résultats de cette étude seront particulièrement importants pour faire face aux pandémies à venir. « Une meilleure compréhension de la dynamique d’adaptation des virus à l’humain au cours d’une pandémie sur une longue période nous permet de développer des modèles pour les pandémies futures », souligne la professeure Schünemann. Cette approche interdisciplinaire, combinant des schémas de transmission historico-épidémiologiques et génétiques, établit une base factuelle pour des calculs susceptibles d’aider à prédire et à atténuer de futures flambées.